- DÉCENTRALISATION
- DÉCENTRALISATIONLes organes administratifs centraux ne peuvent, par eux-mêmes, assurer l’accomplissement des tâches administratives en chaque point du territoire. Il faut des relais locaux à leur action. Pour l’aménagement de ces structures locales, deux nécessités sont à prendre en considération: un minimum d’homogénéité doit exister dans l’action administrative exercée sur l’ensemble du territoire, faute de quoi l’unité nationale disparaît; mais l’existence d’aspirations propres à certaines parties du territoire ne doit pas être méconnue, l’administration devant s’adapter à la diversité des administrés. À l’impératif d’unité correspond la centralisation ; à la revendication de diversité, la décentralisation. L’organisation administrative locale n’opte jamais absolument pour l’unité ou pour la diversité. Elle s’efforce de faire un dosage savant entre les deux formules. L’unité et la diversité sont toutes deux prises en considération à des degrés divers dans chaque système choisi.Certains pays (la France par exemple) ont longtemps été marqués par une tendance profonde à la centralisation. D’autres États ont, au contraire, choisi une solution fédérale, qui laisse une large possibilité d’expression aux autonomies locales (États-Unis, Allemagne). L’évolution actuelle conduit à une certaine uniformisation des régimes. Dans les États fédéraux, un mouvement centripète a réduit le pouvoir de décision local (États-Unis). Les États centralisés ont été obligés de reconsidérer leurs structures (France). La centralisation excessive et l’autonomie absolue apparaissent également comdamnées au bénéfice d’une collaboration des centres de décision nationaux et locaux.Raison d’êtreLa centralisation, même lorsqu’elle s’accompagne d’une déconcentration (qui consiste, pour le pouvoir central, à remettre des pouvoirs de décision à ses propres agents locaux et non, comme c’est le cas de la décentralisation, à des organes ou personnes élus par les administrés), implique le rattachement à l’État de tous les actes administratifs, y compris ceux dont la portée est localisée. Avec la décentralisation, un pas important est franchi, apparaissent de nouvelles personnes publiques autonomes à ressort territorial ou à compétence limitée: les collectivités territoriales ou les établissements publics. La décentralisation implique la gestion par les administrés des affaires qui les concernent le plus directement.Elle permet d’associer les administrés à la prise des décisions. L’intérêt de ceux-ci pour tout ce qui concerne leur cadre de vie immédiat est évidemment plus grand que celui qu’ils peuvent porter à des décisions nationales. Le «localisme», dans la vie publique, n’est pas forcément un défaut, s’il permet d’amorcer la participation politique du citoyen. La décentralisation peut constituer, en effet, un cadre commode d’éducation politique. Initiés à la gestion de leur cité, les citoyens appréhenderont mieux les problèmes politiques nationaux. L’apprentissage des cadres politiques pourra ainsi commencer à l’échelon local.La décentralisation constitue aussi un corollaire indispensable de la démocratie. Elle correspond, pour l’organisation administrative, à ce qu’est la démocratie représentative pour l’organisation constitutionnelle. Elle permet de créer des collectivités territoriales ou des établissements publics: autant de freins aux velléités autoritaires du pouvoir central. Cela est particulièrement exact sur le plan territorial. Associations naturelles de citoyens, les collectivités territoriales seront des corps intermédiaires bienfaisants, qui pourront s’interposer entre l’individu et l’État. Elles susciteront des règles adaptées à chaque cadre géographique et «personnaliseront» l’autorité de l’État en fonction des problèmes locaux.La décentralisation constitue en outre une excellente formule d’organisation du travail dans l’État. Le développement des fonctions de l’État est tel que les organismes centraux de décision peuvent se trouver paralysés, ou tout au moins ralentis dans leur action. Les administrations centrales se trouvent également dans l’impossibilité d’apprécier les nécessités propres à chaque catégorie de citoyens. La décentralisation permet de libérer le pouvoir central et de confier les responsabilités à ceux qui sont les plus compétents pour les résoudre. Elle est une condition d’efficacité pour toute grande entreprise.Ces qualités ne doivent cependant pas dissimuler les écueils inévitables que rencontre toute politique de décentralisation. Un abus dans ce domaine provoque la montée des particularismes, qui peut remettre en cause l’unité nationale. Il entraîne, à plus ou moins long terme, un choc en retour: l’État, sous prétexte de coordination, reprend les prérogatives qu’il avait un moment conférées aux collectivités locales. En outre, la solution locale des problèmes locaux par des élus liés aux populations locales entraîne inévitablement des décisions inspirées par une politique locale, qui pourrait donc être celle d’un groupe de pression. L’arbitrage en faveur de l’intérêt général se fait plutôt dans la capitale que dans les cellules décentralisées. La décentralisation peut également alourdir le processus de décision, les notables locaux ne présentant pas toujours des qualités administratives aussi évidentes que celles des fonctionnaires de métier. Les administrateurs de vocation ne manquent jamais d’incriminer les fautes commises par ces gestionnaires d’occasion que sont les élus locaux. Les fonctionnaires des administrations centrales, au nom des exigences de l’efficacité, sont les plus farouches adversaires de la décentralisation. Cette attitude ne s’explique pas uniquement par le souci de l’intérêt général. Elle procède également de considérations d’amour-propre. Près du pouvoir politique, les fonctionnaires centraux se montrent fort jaloux de leurs prérogatives. Ainsi s’explique la difficulté d’implanter ou de développer la décentralisation dans des pays où les administrations centrales sont puissantes (Italie, France), alors qu’elle est naturellement acceptée dans les États où les administrations ne détiennent que des compétences résiduelles (Royaume-Uni).L’exposé de ces difficultés ne doit pas, cependant, faire oublier les avantages évidents de la décentralisation. Il montre simplement que cette voie est parsemée d’embûches. Avant de décentraliser, on doit avoir ces problèmes présents à l’esprit. La mesure dans laquelle on doit décentraliser varie selon les traditions historiques, le cadre géographique, les ressources économiques, le degré d’instruction civique ou politique.Décentralisation territorialeLa décentralisation territoriale produit des collectivités territoriales, personnes publiques gérées par les citoyens vivant sur leur territoire.Elle suppose l’existence d’une communauté d’intérêts entre les habitants d’une fraction géographiquement déterminée du territoire, communauté qui se traduit par l’apparition d’affaires locales distinctes des problèmes nationaux. Plus la solidarité territoriale sera forte, plus nombreuses seront les affaires locales . Sociologiquement, cette solidarité dépend des dimensions du cadre territorial. Forte dans une petite commune, elle est beaucoup plus superficielle dans une grande agglomération, encore plus faible à l’échelle d’une région.La création d’une personne publique locale marque la volonté d’individualiser les affaires locales, dont la gestion sera remise aux habitants intéressés. Les actes accomplis le seront au nom de cette personne publique. Celle-ci disposera de biens propres, d’un budget particulier. Elle pourra agir en justice pour défendre ses prérogatives.La décentralisation territoriale implique une certaine autogestion locale. L’élection, par la population concernée, de représentants chargés d’administrer les affaires constitue le meilleur moyen d’assurer l’autonomie locale. Sans doute, les autorités locales , chargées d’administrer la collectivité, ne sont-elles pas toujours élues. Le pouvoir central peut mettre certains agents à la disposition de la collectivité locale. Mais il n’y a pas de décentralisation véritable si toutes les attributions de la collectivité locale sont conférées à des agents dépendant du pouvoir central.L’étendue de la décentralisation se mesure d’après le volume des affaires dont la portée locale est reconnue, le mode de désignation des responsables locaux (élection plutôt que désignation par le pouvoir central), le pouvoir reconnu à ces responsables sur les affaires locales (pouvoir de décision plutôt que de consultation).Tous ces éléments dépendent de considérations plus politiques qu’administratives. La décentralisation territoriale est liée au libéralisme. Elle permet d’assurer l’existence des libertés locales, qui feront contrepoids aux pouvoirs de l’État. La déconcentration est une simple adaptation de l’autoritaire centralisation, qui ramène tout à l’État. La décentralisation permet la naissance d’unités autonomes réalisant une démocratie locale.Décentralisation techniqueOn rapproche souvent de la décentralisation territoriale la décentralisation technique. Lorsque la personnalité morale est conférée à un service déterminé détaché, de ce fait, de la masse des services de l’État, l’établissement public ainsi constitué témoignerait d’une décentralisation technique. L’application à cette situation du concept de décentralisation soulève des controverses.Les moyens juridiques mis en œuvre dans le domaine technique et dans le domaine territorial sont les mêmes. L’établissement public suppose l’existence d’affaires administratives spécialisées remises à une personne morale nouvelle. Il peut être le cadre d’une certaine autogestion, les personnes intéressées au fonctionnement du service se trouvant associées à sa gestion. Démembrement de l’administration, il suppose l’existence d’un contrôle de tutelle.La décentralisation technique recouvre néanmoins une réalité spécifique. Elle est souvent, pour l’État, un simple mode d’organisation du travail sans qu’il souhaite réellement remettre la gestion aux personnes intéressées. Tel est, par exemple, le cas dans le domaine des entreprises publiques. Il arrive cependant que, dans des domaines spécifiques – l’enseignement ou l’audiovisuel par exemple –, la personnalisation d’un service s’accompagne d’une certaine autonomie de gestion. Il reste que l’idée d’autogestion est moins prononcée dans la décentralisation technique que dans la décentralisation territoriale.Limites de la décentralisationLa situation d’une collectivité territoriale décentralisée se distingue de celle de l’État membre d’un État fédéral. Le fédéralisme est une technique d’aménagement du pouvoir politique. Il atteint la structure même de l’État en réalisant un démembrement de ce pouvoir dans des matières déterminées (législatives, exécutives, juridictionnelles). L’État membre de l’État fédéral jouit d’une compétence propre, qui lui est accordée par la Constitution et sur laquelle l’État fédéral n’exerce pas de contrôle. La décentralisation se situe, en revanche, sur le terrain administratif. La collectivité décentralisée n’acquiert de compétences qu’en matière administrative. Celles-ci sont définies par la loi: la spécialité de la collectivité territoriale se trouve ainsi commandée par la volonté du législateur. Par ailleurs, dans la gestion des affaires locales la collectivité territoriale est soumise à un contrôle de l’État: la tutelle .La distinction de la décentralisation et du fédéralisme est justifiée sur le plan juridique. En pratique, il est beaucoup plus difficile de distinguer entre l’État membre d’un État fédéral et la collectivité décentralisée. Dans un cas comme dans l’autre, en effet, le but recherché est le même, il s’agit de reconnaître l’autonomie des populations locales dans la gestion des affaires qui leur sont propres. Le fédéralisme est ainsi la forme la plus poussée de décentralisation. Si l’on adopte un tel point de vue, il n’y a pas une barrière infranchissable entre des pays comme l’Allemagne ou la Suisse, qui ont opté pour le fédéralisme, et des États unitaires plus ou moins décentralisés comme le Royaume-Uni ou la France.La tutelle est le contrôle exercé sur les collectivités territoriales. Certains pays en remettent l’exercice principalement à des fonctionnaires. D’autres font davantage confiance au juge (Royaume-Uni). Quoi qu’il en soit, le but du contrôle est le même. Le pouvoir politique central est le seul souverain. Il doit, par conséquent, maintenir l’unité et la cohésion du pays. Il s’agit d’éviter les conséquences les plus graves d’une mauvaise gestion des collectivités décentralisées et d’assurer l’unité d’interprétation de la loi sur l’ensemble du territoire. Politiquement, l’existence de la tutelle ne peut être discutée dans un État unitaire. Le système juridique local n’a d’existence que par son insertion dans le système national.L’autonomie locale peut être sauvegardée malgré l’existence de la tutelle. L’autorité de tutelle ne doit, en effet, exercer son contrôle que dans des cas limitativement énumérés et sans jamais pouvoir donner d’ordres aux organes de la collectivité décentralisée: la tutelle met en rapport deux personnalités morales distinctes et il est nécessaire de sauvegarder la personnalité de la collectivité contrôlée. Elle se distingue ainsi du pouvoir hiérarchique qui s’exerce à l’intérieur d’une même personne morale. Ce pouvoir, à la différence de la tutelle, peut s’exercer même s’il n’a pas été expressément prévu. En principe, il donne au supérieur hiérarchique un pouvoir général d’autorité à l’égard de ses subordonnés.Le contenu du pouvoir de tutelle est prévu, dans chaque cas, par les textes particuliers qui organisent celle-ci selon certaines techniques traditionnelles. La tutelle peut s’exercer sur les organes de la collectivité décentralisée. La nomination par l’autorité de tutelle est le procédé le plus énergique. À l’égard d’un organe élu, celle-ci peut disposer d’un pouvoir disciplinaire (suspension, révocation). La tutelle sur les actes peut aller d’un contrôle général de l’opportunité à un simple contrôle de la légalité. Elle peut s’exercer soit avant l’entrée en vigueur de l’acte (approbation), soit a posteriori (annulation). Dans des cas exceptionnels, devant une abstention caractérisée des organes de la collectivité locale, l’autorité de tutelle peut se substituer à eux.Le respect de l’autonomie de la collectivité contrôlée exige que le pouvoir de substitution ne soit utilisé qu’exceptionnellement, dans le seul cas d’abstention coupable de l’autorité locale et que l’approbation préalable soit rarement requise. Le principe doit être l’entrée en vigueur immédiate des décisions de la collectivité locale en réservant à l’autorité de tutelle la possibilité de les annuler dans des cas déterminés.La décentralisation est également plus forte lorsque l’autorité de tutelle reçoit le pouvoir de sanctionner les seules illégalités sans pouvoir contrôler l’opportunité des décisions.
décentralisation [ desɑ̃tralizasjɔ̃ ] n. f.• 1829; de décentraliser♦ Action de décentraliser; son résultat. Décentralisation et polycentrisme. ⇒ régionalisation. Décentralisation administrative, par laquelle la gestion administrative d'une région est remise à des autorités locales élues (et non à des agents nommés par le pouvoir central ⇒ déconcentration ). — Décentralisation industrielle. ⇒ délocalisation. ⊗ CONTR. Centralisation.
● décentralisation nom féminin Système d'organisation des structures administratives de l'État dans lequel l'autorité publique est fractionnée et le pouvoir de décision remis à des organes autonomes régionaux ou locaux. Politique d'aménagement du territoire visant à rétablir l'équilibre entre Paris et la province en incitant les entreprises industrielles et commerciales à transférer leurs usines et leurs bureaux en province. Ensemble des méthodes d'organisation et de gestion consistant à transférer le pouvoir de décision aux niveaux hiérarchiques inférieurs.décentralisationn. f. ADMIN Système dans lequel une collectivité ou un service technique s'administrent eux-mêmes sous le contrôle de l'état.— Mise en oeuvre de ce système.⇒DÉCENTRALISATION, subst. fém.Dissociation d'éléments réunis en un même centre. Anton. centralisation. — La décentralisation demandée par le gouvernement a eu pour conséquence la création des centres provinciaux de Grenoble et de Cadarache — (GOLDSCHMIDT, Avent. atom., 1962, p. 244).— En partic. [Le compl. du nom, explicite ou non, désigne un pouvoir gén. admin. ou pol.] Décentralisation du pouvoir; décentralisation administrative. Au sommet de l'État, l'autorité, sur le sol et dans les groupes, la décentralisation (BARRÈS, Cahiers, t. 2, 1898-1902, p. 293).Prononc. et Orth. :[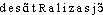 ]. Ds Ac. dep. 1878. Étymol. et Hist. Av. 1829 (Méchin ds BOISTE). Dér. de décentraliser; suff. -(a)tion. Fréq. abs. littér. :23. Bbg. PUCHEU (R.). Gloss. ou les mots de l'amén. Fr. Monde. 1972, n° 93, pp. 107-108.décentralisation [desɑ̃tʀalizɑsjɔ̃] n. f.ÉTYM. Déb. XIXe; de décentraliser.❖♦ Action de décentraliser; son résultat. || Décentralisation politique (→ Centraliser, cit.). || Décentralisation administrative (décentralisation territoriale), par laquelle la gestion administrative d'une région est remise à des autorités locales élues (et non à des agents nommés par le pouvoir central; → Déconcentration). || Décentralisation industrielle. ⇒ aussi Délocalisation.1 (…) l'augmentation du nombre des services publics implique une décentralisation de plus en plus grande de ces services.Léon Duguit, Traité de droit constitutionnel, t. II, p. 66.2 La tournée que je viens de faire à travers le Maroc m'a de plus en plus convaincu qu'il n'y a pas de réalisations possibles sans la plus large décentralisation, et que nous n'arriverons à rien si, partout, les représentants des intérêts locaux n'ont pas voix prépondérante pour ce qui doit se faire chez eux.L. H. Lyautey, Paroles d'action, p. 187.❖CONTR. Centralisation.
]. Ds Ac. dep. 1878. Étymol. et Hist. Av. 1829 (Méchin ds BOISTE). Dér. de décentraliser; suff. -(a)tion. Fréq. abs. littér. :23. Bbg. PUCHEU (R.). Gloss. ou les mots de l'amén. Fr. Monde. 1972, n° 93, pp. 107-108.décentralisation [desɑ̃tʀalizɑsjɔ̃] n. f.ÉTYM. Déb. XIXe; de décentraliser.❖♦ Action de décentraliser; son résultat. || Décentralisation politique (→ Centraliser, cit.). || Décentralisation administrative (décentralisation territoriale), par laquelle la gestion administrative d'une région est remise à des autorités locales élues (et non à des agents nommés par le pouvoir central; → Déconcentration). || Décentralisation industrielle. ⇒ aussi Délocalisation.1 (…) l'augmentation du nombre des services publics implique une décentralisation de plus en plus grande de ces services.Léon Duguit, Traité de droit constitutionnel, t. II, p. 66.2 La tournée que je viens de faire à travers le Maroc m'a de plus en plus convaincu qu'il n'y a pas de réalisations possibles sans la plus large décentralisation, et que nous n'arriverons à rien si, partout, les représentants des intérêts locaux n'ont pas voix prépondérante pour ce qui doit se faire chez eux.L. H. Lyautey, Paroles d'action, p. 187.❖CONTR. Centralisation.
Encyclopédie Universelle. 2012.
